Corpus épigraphique et étude.
Ouvrage d'Isabelle Pernin, chercheur associé au laboratoire HiSoMA. Ce livre contient 259 inscriptions grecques antiques relatives à la pratique locative en milieu rural (location de terres agricoles et de bâtiments construits sur ces terres). Si ce recueil ne comporte aucun inédit, il rassemble pour la première fois des documents publiés dans des éditions très variées et pour certains jamais traduits en français. Les inscriptions conservées proviennent essentiellement de Grèce continentale, des îles de la mer Égée ou d’Asie Mineure et sont concentrées sur les quatre derniers siècles avant J.-C...
Résumé et sommaire du TMO 66 - Publications MSH MOM
Publications

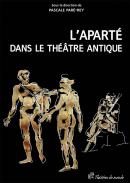
édité par Pascale Paré-Rey
Collection : Théâtres du monde. Presses Universitaires de Vincennes, 2015, 26 euros.
ISBN : 978-2-84292-419-5
L’aparté dans le théâtre antique existe-t-il ? Bien qu’il ait été relativement ignoré jusqu’à présent, ce livre répond par l’affirmative, tente d’en cerner les contours et d’en définir les formes et les fonctions.
Voir le sommaire

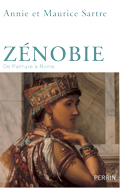
Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre, Biographies, Perrin, Paris, 2014, 350 pages, ISBN 978-2-262-04097-0, 21 x 14 cm, 23,5 €.
Au même titre que Cléopâtre, la reine Zénobie est cette souveraine de l’Antiquité dont le mythe a assuré la célébrité. Qu’importe que le « royaume » de Palmyre, cité romaine, n’ait jamais existé, et qu’on sache peu de choses de la vie de sa reine supposée. Reste que, pendant les quelques années du IIIe siècle apr. J.-C. où elle domina une partie de l’Orient, jusqu’à s’attribuer le titre d’impératrice de Rome, cette femme politique qui ne s’encombra d’aucun homme joua un rôle considérable au moment où la Syrie était prise entre l’ébranlement du pouvoir à Rome et la pression militaire des Perses sassanides. Entourée d’une cour brillante où s’exerçaient des influences variées, elle fit de Palmyre, pour un temps, l’un des centres du pouvoir et de l’intelligence. Après sa capture par l’empereur Aurélien en 273, elle fut aussitôt emportée par la légende, à la fois dans la tradition littéraire et artistique occidentale et dans l’historiographie arabe. De l'histoire au mythe, les auteurs explorent avec soin la documentation pour cerner au plus près les images multiples d'une femme exceptionnelle.

Mélanges offerts au professeur Françoise Skoda
Sous la direction d'Isabelle Boehm et de Nathalie Rousseau
On trouvera dans cet ouvrage des réponses aux nombreuses questions auxquelles sont confrontés à la fois les spécialistes de médecine et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du vocabulaire médical : les philologues et les linguistes spécialistes des textes anciens qui sont intervenus dans ce volume éclairent d’un jour nouveau les sens de mots difficiles en grec, en latin ou en arabe, et contribuent à la diffusion de textes importants pour l’histoire de la pensée médicale, tous donnés en version bilingue.
Les réflexions proposées ici sur la naissance et le développement du lexique scientifique (anatomie, pathologie, chirurgie, pharmacologie, thérapeutique, botanique, zoologie) pourront servir plus largement à affiner, compléter, enrichir une terminologie qui ne cesse de se développer, celle de la langue scientifique de l’Europe moderne.
- Sommaire de l'ouvrage (.pdf)

Hommages édités par Alessandro Garcea, Marie-Karine Lhommé, Daniel Vallat. Série Spudasmata 155.1-2 (2 vol.), Olms, Hildesheim, 2013, XX/874 p. ISBN : 978-3-487-15086-4 - 176€.
On trouvera ici réunies des études offertes à Frédérique Biville, professeur de langue et littérature latines à l’Université Lumière Lyon 2, à qui des collègues, élèves et amis ont ainsi souhaité rendre hommage.
La diversité des sujets abordés est à l’image des centres d’intérêt de leur destinataire, qui n’a cessé de décloisonner les disciplines du monde antique : philologie (morpho-syntaxe, sémantique et lexique, pragmatique), bilinguisme et littérature (échanges culturels, littérature gréco-latine), littératures techniques (médecine, histoire de la grammaire). La linguistique des langues anciennes - discipline technique qui a sa méthode et ses objectifs - se révèle ainsi une science capable de parler à un public plus large que celui des spécialistes et un instrument heuristique très puissant pour d’autres disciplines.
- Table des matières (.pdf)

Etude des relations internationales au IVe siècle a.C.
par Christian Bouchet (Professeur à l'université de Lyon 3 / HiSoMA)
Collection Scripta antiqua (60). Bordeaux, 2014 - 278 p. 25 €
Trop souvent et trop longtemps considéré comme un intellectuel de bureau, éloigné de la tribune, Isocrate mérite très certainement une étude renouvelée, tant sa pensée politique s’est affirmée, avec force souvent et avec subtilité à l’occasion. Maître de rhétorique, d’abord proche des sophistes, Isocrate a, durant sa très longue vie (436-338), assisté à nombre d’événements qui devaient altérer ou réformer la démocratie athénienne (guerre du Péloponnèse, dissolution de la ligue de Délos en 404/3 et création de la seconde Confédération maritime en 378, guerre des Alliés en 357-355 et ascension de Philippe II de Macédoine dans ces mêmes années 350). Bien présents dans les discours et les lettres du rhéteur, tous ces faits s’ordonnent en fonction de la question sans cesse posée de l’hégémonie athénienne. Pour Isocrate, sa cité aspire légitimement à l’hégémonie, à la prééminence en Grèce, face aux prétentions de Thèbes et surtout de Sparte ; et lorsque les rapports de force deviennent franchement défavorables à Athènes, dans les années 360-350, il envisage une autre forme d’hégémonie, distincte de l’archè. Le vocabulaire de la domination militaire et politique laisse alors la place à un registre plus politique et culturel. C’est ce glissement sémantique qu’analyse le présent ouvrage, ponctué par une traduction nouvelle du Sur la Paix (356/355).
Voir le site de l'éditeur

par Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre, Bibliothèque archéologique et historique (BAH), 204, Presses de l’Ifpo, Beyrouth, 2014, ISBN 978-2-35159-395-0, 28 x 22 cm, 730 p., 2 volumes (358 + 392 p.), 80 €.
Le nouveau tome des IGLS regroupe toutes les inscriptions grecques et latines du plateau du Lejā, vaste triangle basaltique au sud de Damas, que les Anciens nommaient le Trachôn, le « Rugueux », ce qui traduit bien son aspect sauvage et désolé. Ces textes illustrent la vie dans l’Antiquité des villages de la région qui sont répartis à la fois sur le pourtour du plateau et sur le plateau lui-même, surtout dans la moitié sud, plus propice aux cultures. Ils appartiennent à tous les genres habituels des inscriptions grecques, consécrations en l’honneur des dieux et déesses, dédicaces en l’honneur des empereurs et des agents impériaux de haut rang (gouverneurs notamment), commémoration de constructions publiques ou privées, épitaphes, bornes milliaires de la route romaine qui le traverse du nord au sud. Une partie avaient été publiés auparavant, trouvés par les voyageurs et savants qui ont parcouru la région depuis le début du XIXe siècle, mais une partie non négligeable sont des inédits découverts par les auteurs des deux volumes lors de leurs nombreuses visites sur le terrain.
Consulter le sommaire
En savoir plus sur le programme des IGLS

La nature et son espace littéraire dans l'épigramme gréco-latine tardive
Textes réunis et préparés par Florence Garambois et Daniel Vallat.
Collection Antiquité. Mémoires du Centre Jean Palerne. ISBN 978-2-86272-639-7. 35 €
Le renouveau du genre épigrammatique dans la littérature gréco-latine aux IVe-VIe siècles de notre ère s’effectue dans un monde qui connaît et affronte, à tous les niveaux, y compris ceux de l’éducation et de la culture, des mutations profondes, qui précipiteront la fin de l’Antiquité et l’avènement du Haut Moyen Âge. Dans cette dernière période antique, l’épigramme reste un genre littéraire fondamentalement urbain et sophistiqué, malgré les prémisses du déclin de la civilisation urbaine : le but de cet ouvrage est justement d’analyser comment l’épigramme représente un thème qu’on pourrait considérer comme son « négatif » : la nature. Entre héritage d’une tradition millénaire, réappropriation littéraire et innovations dans de nouvelles conditions historiques, se crée une tension qui, loin de tout épanchement romantique, se résout par une instrumentalisation des éléments naturels par l’épigramme.

par P. Faure et N. Tran (avec la collaboration de B. Rémy)
CNRS Éditions (XLIVe Supplément à Gallia), Paris, 2013, 226 p.
Depuis la publication par Otto Hirschfeld, en 1888, du tome XII du Corpus Inscriptionum Latinarum et du supplément qu’Émile Espérandieu lui ajouta en 1929, les découvertes épigraphiques se sont multipliées sur le sol de la province romaine de Narbonnaise. Des prospections ont permis de retrouver des inscriptions que l’on croyait perdues du temps d’O. Hirschfeld. De nouvelles lectures ont amélioré certaines leçons du CIL.
Dirigée à l’origine par Jacques Gascou, la collection des Inscriptions latines de Narbonnaise s’est donné pour objectif de publier, cité par cité, toutes les inscriptions latines connues à ce jour (à l’exception des inscriptions chrétiennes et des textes de l’instrumentum), en les accompagnant systématiquement de photographies ou de dessins et en leur adjoignant un substantiel commentaire onomastique et historique.
Ce volume, consacré à la cité de Valence (ILN, tome VIII ), comprend quatre-vingt-cinq inscriptions provenant du territoire de l’ancienne colonie, qui s’étendait sur les deux rives du Rhône et sur une grande partie des actuels départements de la Drôme et de l’Ardèche. Les cinquante-six inscriptions découvertes à Valence illustrent la prééminence du centre urbain, mais l’épigraphie témoigne également du développement de la petite agglomération installée à Soyons, sur la rive droite du fleuve. Le corpus se compose de dédicaces aux divinités, d’hommages aux empereurs ou à de hauts personnages, de bornes milliaires et surtout de nombreuses épitaphes. Il est précédé d’une longue introduction où sont étudiées les limites du territoire et l’histoire de la cité, de la conquête romaine au IIIe siècle.
Le réexamen des sources permet de formuler des hypothèses nouvelles sur le statut originel et sur la date de fondation de la colonie de Valence.
Des discussions approfondies traitent des institutions municipales, de la société, de la présence de Lyonnais sur le territoire valentinois, des cultes, mais également de la provenance des textes, de la typologie des monuments inscrits et de l’historique des recherches épigraphiques.
Des cartes, des tableaux, des indices très détaillés et des tables de concordance complètent ce recueil.
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- Page suivante
- Dernière page