[Projet scientifique Axe A | Savoirs, normes et doctrines | Étude et réception des sources bibliques, patristiques et médiévales]
BiblIndex. Index en ligne des citations bibliques dans la littérature chrétienne de l'Antiquité et du Moyen Âge
Laurence Mellerin, IR CNRS
● Guillaume Bady
● Isabelle Brunetière
● Aline Canellis
● Yasmine Ech Chael
● Dominique Gonnet
● Élysabeth Hue-Gay
● Alice Leflaëc
● Bernard Meunier
● Jules Nuguet
● Jean Reynard
● Blandine Sauvlet
● Catherine Syre
Partenaires institutionnels extérieurs
Les travaux de BiblIndex s’inscrivent dans le programme de l’Équipex+ Biblissima+ (2021-2029). Cette collaboration porte sur l’utilisation de protocoles communs à l’ensemble du consortium pour la conception des bases de données textuelles, l’encodage XML-TEI des textes stockés, l'alignement des métadonnées sur des référentiels communs et le développement d’outils linguistiques mutualisables.
De façon structurelle, l’Association des Amis des Sources Chrétiennes (Lyon) soutient le projet, financièrement et par le travail de son personnel.
Le Centre d’Analyse et de Documentation Patristiques de Strasbourg (CADP), à Strasbourg, édite les Cahiers de BiblIndex.
L’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem est partenaire de l’atelier « Ecclésiaste », et des alignements et interconnexions de données sont en cours entre les deux projets.
La société d’informatique JANALIS assure le suivi du développement informatique du projet depuis 2018.
D’autres collaborations plus ponctuelles sont mises en place en fonction des aspects du projet développés, en particulier, de 2022 à 2024, avec le projet The Bible in Middle Byzantine Hagiography (8th–10th century) de l'Université de Cologne et de la KU Leuven.
Résumé du projet
Le projet a pour objet l’étude de la réception de la Bible dans les écrits chrétiens de l’Antiquité et du Moyen Âge, à partir d’un index, à vocation exhaustive, des citations et allusions scripturaires présentes dans ces corpus.
Son cœur est le site https://biblindex.org : entièrement en open access, il est hébergé sur la plateforme HumaNum. On y trouve, tout comme sur le carnet de recherche https://biblindex.hypotheses.org/, des informations sur le projet, notamment sa bibliographie régulièrement mise à jour. Le développement de Biblindex est fondamentalement pluridisciplinaire : s’il fait en premier lieu appel aux compétences des patrologues connaisseurs de la Bible, pour le repérage des citations dans les œuvres en latin, grec, syriaque principalement, et pour l’analyse des usages scripturaires des différents auteurs, il nécessite aussi le recours à des outils informatiques performants qui sont en eux-mêmes des objets de recherche.
La première utilité de BiblIndex est son index de citations bibliques. Entre 2021 et 2025, le corpus d'occurrences traitées – qui fournit les références des citations ou allusions (livre, chapitre, verset bibliques liés à un numéro de page, de ligne, dans une édition donnée d’un texte patristique) – est passé de 370.000 références à 640.000, avec l'intégration de grands auteurs comme Athanase d'Alexandrie, Jérôme (qui étaient déjà partiellement traités), mais aussi Cyrille d'Alexandrie et partiellement Augustin. De nombreuses œuvres anonymes, notamment liturgiques, ont été dépouillées. Le versement d'environ 300.000 données supplémentaires est prévu en 2025. Un nouveau formulaire de recherche, beaucoup plus performant que le précédent qui datait de 2008, a été mis en service fin 2024 pour faciliter l'interrogation du corpus.
L'interface pour la visualisation paramétrable, en synopse, de douze Bibles en langues anciennes (hébreu, grec, latin) et en traduction française ou anglaise, a été améliorée, devenant en particulier plus rapide. L'ajout de la Bible syriaque (Peshitta) est en cours et sera effectif au premier semestre 2025.
Exemple de visualisation synoptique sur le site de Biblindex
Les métadonnées du projet concernant les auteurs anciens et leurs œuvres exploitées dans l’index ont été largement augmentées en 2023-2024: les auteurs anciens et une partie des œuvres ont été alignés avec la BnF, la Library of Congress, la Clavis Clavium, Pinakes, Biblissima, le CERL, Wikidata, et ce travail se poursuivra en 2025-2026.
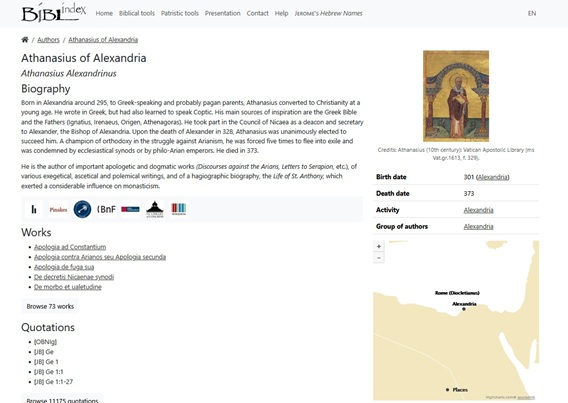
Exemple de fiche auteur
Dans le précédent quinquennal, grâce aux financements successifs de l’ANR (2011-2015), de la BSN5 (2015-2016), de la Fondation de Montcheuil et de l’Association des Amis de Sources Chrétiennes (2017-2020), nous avons essentiellement travaillé sur la liaison entre l’index des citations et le texte biblique cité. L’axe majeur pour ce quinquennal concerne la liaison entre l’index et les textes citants : la réflexion méthodologique sur ses modalités, leur mise en œuvre, l’exploitation des informations nouvelles qu’elle peut générer. En 2024 a été créée la base BibliText, base XML native structurée par DoTS, dont la vocation est de rassembler tous les textes patristiques contenant des citations bibliques référencées dans BiblIndex pour en proposer un affichage partiel lors des recherches de citations. Son développement informatique est assuré par Jules Nuguet. Actuellement, elle ne fonctionne que sur un corpus échantillon, constitué d’œuvres de Jérôme de Stridon et d'Isaac de l’Étoile, mais son développement est une priorité pour 2025. Les textes y sont tokenisés, lemmatisés, et encodés en TEI avec un balisage fin des occurrences bibliques, sous la supervision d’Élysabeth Hue-Gay.
Des expérimentations ont été menées, en partenariat par exemple avec l’Université d’Anvers, dans les domaines de la détection automatisée de l’intertextualité, de la visualisation spatio-temporelle de données statistiques, de l’usage de la linguistique outillée pour l’exploration des corpus textuels (Voir E. Manjavacas, L. Mellerin, M. Kestemont, « Quantifying Contextual Aspects of Inter-annotator Agreement in Intertextuality Research », Proceedings of LaTeCH-CLfL 2021, Punta Cana, Dominican Republic (Online), November 11, 2021 [https://aclanthology.org/2021.latechclfl-1.4.pdf]).
À partir de 2025-2026, des outils nouveaux de requêtage par séquence textuelle seront développés et intégrés au site : ils permettront notamment des recherches sur l’ensemble des textes bibliques et patristiques, ou le repérage des procédés introducteurs des citations. Par verset ou par séquence textuelle, des cooccurrences pourront être repérées. Par ailleurs, des visualisations statistiques seront proposées : concentration de citations en tel ou tel lieu ; évolution du spectre des textes cités au fil du temps ; similitudes entre auteurs et œuvres, etc. Ces aspects sont particulièrement développés dans le cadre de l’Équipex+ Biblissima+, en vue d’une mutualisation des outils développés à d’autres projets. Depuis 2024, l'intégration de BiblIndex dans Biblissima+, et spécialement dans son Cluster 7 "Interopérabilité et analyse des textes", co-coordonné par Laurence Mellerin, contribue fortement au développement de ces travaux. BiblIndex est au cœur d'un nouveau groupe de travail sur l'intertextualité qui a démarré en novembre 2024 avec la semaine des Clusters 5b et 7 organisée à Lyon. Une première présentation des recherches sur l'intertextualité psalmique dans les écrits du Nouveau Testament faites dans le cadre de BiblIndex sera donnée à l'EuARE (Vienne, juillet 2025), une autre à Catane (octobre 2025) dans le colloque conclusif du projet européen PRIN 2022 "Resilient Septuagint". Un post-doctorant sera recruté de novembre 2025 à octobre 2026 pour développer des outils mutualisables de recherche d'intertextualité biblique.
BiblIndex, c'est aussi un séminaire de recherche mensuel, co-animé par Laurence Mellerin et Alice Leflaëc, qui accompagne le projet depuis 2006 (voir son programme sur le carnet de recherche), outre les questions méthodologiques, s’attache à exploiter les données collectées pour répondre à un certain nombre de questions : qui lit la Bible, qu’y lit-on, que fonde-t-on sur elle en termes d’expression littéraire, de doctrine et de dogmes, de pensées philosophiques – qu’il s’agisse de métaphysique ou d’anthropologie ? Comment la lit-on, selon quelles méthodes exégétiques et à travers quels débats ? Comment l’édite-t-on, la recopie-t-on, la diffuse-t-on à l’écrit et à l’oral, par exemple dans la liturgie ? Les communications, données par des membres de l’équipe et des intervenants extérieurs, sont publiées pour une bonne part dans les Cahiers de Biblindex.
Au cours de ce quinquennal sont parus deux volumes: Laurence Mellerin (éd.), Le puits des eaux vives, Cahiers de BiblIndex 3, Coll. Biblia Patristica 22, Strasbourg 2021 ; Guillaume Bady (éd.), La source sans fin. La Bible de Jean Chrysostome, Cahiers de BiblIndex 4, Coll. Biblia Patristica 23, Strasbourg 2021 (en lien avec le Programme « Édition de Jean Chrysostome » de l’axe D). Un autre, dédié aux sujets variés issu des rencontres du séminaire, paraîtra courant 2025 ; celui dédié à l’interprétation patristique du livre de l’Ecclésiaste paraîtra en 2026.
Deux sous-projets sont par ailleurs inclus dans Biblindex.
- L’annotation patristique du livre de l’Ecclésiaste dans le cadre du projet Bible En Ses Traditions (BEST)
L’ambition de la BEST, projet de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, est de donner à lire la Bible comme un texte essentiellement pluriel, et dans ses formes textuelles, et dans les réceptions qu’elle a suscitées. L’interface numérique du projet, qui se présente en ligne comme un rouleau, permet à l’internaute de consulter, outre le texte en ses différentes versions, tout ou partie des annotations produites (voir un exemple : http://scroll.bibletraditions.org/bible#best_fr/Gn22.1 et cliquer sur « Notes »). Une partie de l'équipe de Biblindex (Guillaume Bady, Dominique Gonnet, Laurence Mellerin, Bernard Meunier, Jean Reynard), en partenariat avec la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon, prépare depuis 2018 l’annotation du livre de l’Ecclésiaste, par unités textuelles de quelques versets, pour les rubriques de la réception patristique ( voir sur le site des Sources Chrétiennes). Fin 2024, nous avons rédigé plusieurs chapitres du volume en construction (introductions, traductions alignées et commentaires linguistiques, lectures des Qo 1, 1, et 1, 2). Par ailleurs, des liens structurels par API sont en cours de mise en place entre Biblindex et la BEST, et devraient être visibles courant 2025.
Vue du rouleau de l'Ecclésiaste dans la BEST
2. La Bible des cisterciens
Les textes monastiques du xiie siècle, dont l’œuvre de Bernard de Clairvaux, riche de plus de 38.000 occurrences bibliques, servent de corpus-test pour la phase textuelle de BiblIndex, avec l’objectif de mieux caractériser l’évolution de la culture biblique des moines, la nature et l’intensité de leurs échanges, entre eux et avec le monde scolaire. Outre l’œuvre de Bernard de Clairvaux, sont traitées des œuvres de contemporains de l’abbé pour des enquêtes comparatives : début 2025, la préparation en XML-TEI, avec repérage des noms propres et des intertextualités bibliques des textes de Guillaume de Saint-Thierry, Guerric d’Igny, Isaac de l’Étoile et Guigues le Chartreux est très avancée grâce au travail d'Élysabeth Hue-Gay et des stagiaires qu'elle encadre. Ces travaux ont déjà donné lieu à une publication: L. Mellerin, « Isaac of Stella’s Use of the Bible », Cistercian Studies Quarterly 58.1, 2023, p. 47-74 (Underlying dataset: https://doi.org/10.5281/zenodo.8113661).
Seront ajoutés, sous réserve de l’obtention de financements, les textes d'autres grands auteurs cisterciens (Aelred de Rievaulx, Amédée de Lausanne, Gilbert de Hoyland, Baudoin de Ford, Geoffroy d’Auxerre) ; les autres commentateurs du Cantique des Cantiques, de Robert de Tombelaine à Geoffroy ; un représentant de Cluny, Pierre le Vénérable ; un représentant de l’école de Saint-Victor, Richard ; le grand adversaire théologique de Bernard, Pierre Abélard ; une représentante de la culture et de l’exégèse monastique féminine, correspondante de Bernard : Hildegarde de Bingen.
Ce projet est en lien avec le programme « Édition des textes monastiques du XIIe siècle dans la collection Sources Chrétiennes » de l’axe D.