[Projet scientifique Axe C | Espaces, villes et sociétés | Le sacré en mutation]
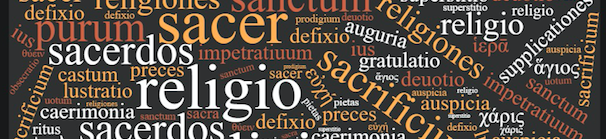
Entre le dire & le faire.
Le vocabulaire religieux des Romains
Porteurs scientifiques
• Romain Loriol, Maître de conférences, Lyon 3
• Nicole Belayche, Directrice d'études, EPHE
Principaux collaborateurs scientifiques du laboratoire
• Marie-Karine Lhommé (Lyon 2)
• Manuel de Souza (Saint-Etienne)
Partenaires institutionnels extérieurs
• Laboratoire ANHIMA (Nicole Belayche, EPHE)
Résumé du projet
Le projet, co-porté par R. Loriol (Lyon 3) pour l’équipe d’HiSoMA et N. Belayche (EPHE) pour AnHiMA, s’inscrit dans une dynamique actuelle de reconsidération du vocabulaire religieux des Romains et des Grecs, s’efforçant de mettre à distance les excès ou les biais d’approches plus anciennes : ceux des enquêtes étymologiques ou linguistiques conduites dans une large première moitié du XXe siècle et parfois peu contextualisées ; ceux induits par le prisme de la culture monothéiste (chrétienne) des savants européens, mis en question après le tournant anthropologique des années 1960-1970 mais encore prégnant dans notre vocabulaire descriptif ; ceux, enfin, d’habitudes terminologiques consacrées par la stratification historiographique, et pourtant faiblement pertinents, voire erronés.
L’examen du vocabulaire part, dans le cadre du programme, d’un terme/une notion, d’un couple de termes/notions ou d’un nuage de termes/notions (de supposés synonymes, antonymes, etc.), pour mettre en question systématiquement l’articulation entre 1) la terminologie antique, 2) les catégories modernes et 3) ce que l’on sait des pratiques ou des faits cultuels. La perspective n’est pas seulement traductologique, mais touche directement à notre compréhension du polythéisme rituel romain lui-même ; pour ne prendre qu’un seul exemple, la lustratio – comme l’a encore récemment montré John Scheid après Henk Versnel et Jörg Rüpke – n’est pas à Rome un rite de purification (compris comme élimination d’une souillure), ainsi que le portent nombre de traductions, mais la délimitation, par un rite de circumambulation, d’un espace ou d’un groupe que le dieu est supposé protéger. On peut multiplier les exemples de telles relectures, récentes ou à mener, qui mises en série conduisent à des réinterprétations d’ensemble des sources anciennes.
Le projet vise donc une meilleure compréhension du rapport entre certaines pratiques ou croyances, et les termes qui les désignent, tant dans une approche synchronique bilingue que dans une perspective diachronique (IIe s. avant notre ère / IVe s. de notre ère).
Types d'opération
Le projet se veut un « incubateur », légèrement différent des projets classiques : nous proposons aux collègues un espace de discussion-atelier autour de leur propre travail en cours, ce qui permet la mise en commun des derniers états de la recherche dans le domaine très dynamique de la recherche sur les polythéismes anciens.
La finalité du projet à moyen terme est l’élaboration collective d’un livre de sources commentées, qui fonctionnera comme un lexique contextualisé de la religion antique ; à court terme, une sélection de contributions des 3 premières rencontres sera publiée sous forme de dossier de revue.
1ère rencontre : 7-8 octobre 2021, Lyon
Programme de la rencontre : religiones à la fin de la République (M. de Souza), sacra chez Festus et Varron (M.K. Lhommé), sacrum facere (Y. Berthelet), signa impetratiua et oblatiua (R. Loriol) et supplicationes au Haut-Empire (F. Van Haeperen). Discutant.e.s : N. Belayche, S. Estienne, N. Laubry, F. Massa, F. Prescendi.
2e rencontre : 13-14 octobre 2022, Paris
Programme de la rencontre : religiones dans l’Antiquité tardive (M. de Souza), l’alliance de termes caerimonia/ae – sacra – religiones (S. Estienne), en prolongement de l’atelier 1 ; sanctus (Th. Lanfranchi), castus, incestus (Ph. Moreau), sacra in operto (N. Corre), sacra, deuotio, defixio dans la magia (Th. Galoppin). Discutant.e.s : N. Belayche, M.K. Lhommé, R. Loriol, F. Massa, F. Prescendi.
3e rencontre : 4-5 avril 2024, Lyon
Programme de la rencontre : uitium en lien avec les auspices/augures (Y. Berthelet) ; uis et autres (P. Lecaudé), numen (E. Rosso) et dunamis (F. Audureau) ; retour sur sanctus et la tripartition (M. de Souza) ; cultor (F. Van Haeperen) et therapeutes et autres (tôn theôn) (D. Cellamare) ; deuouere, deuotio dans l'Antiquité tardive (Th. Galoppin, F. Massa). Discutant.e.s : N. Belayche, N. Corre, S. Estienne, Th. Lanfranchi, M.K. Lhommé, R. Loriol.