Dominique Bertrand, Paris, Éditions du Cerf, 2023, Cerf Patrimoines.
Publications

Introduction, texte grec révisé, traduction et notes par Aline Pourkier, Paris, Éditions du Cerf, 2023, Sources Chrétiennes 631.

Introduction, texte critique, traduction et notes par Bernard Pouderon, Paris, Éditions du Cerf, 2023, Sources Chrétiennes 633.
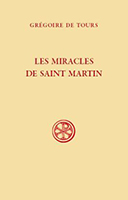
Texte latin de B. Krusch (MGH). Introduction, traduction et notes par Luce Pietri, Paris, Éditions du Cerf, 2023, Sources Chrétiennes 635.

Introduction, texte, traduction et notes par Monseigneur Roger Gryson, Paris, Éditions du Cerf, 2023, Sources Chrétiennes 636.

Pauline Maillard, Lyon MOM Éditions, 2023, Archéologie(s) 9.
Lire.

Études réunies par Pierre Molinié et Marie Pauliat, Paris, Le Cerf, 2023, Théologie historique 134.
Qu’est-ce que prêcher ? Quel statut revêt la parole prononcée par un homme dans un cadre liturgique ? Est‑ce un simple enseignement ou une parole d’une certaine façon adressée par Dieu aux fidèles ? Et en quoi une prédication serait-elle efficace ?
Pour répondre à ces questions, la prédication est parfois comparée aux sacrements de l’Église catholique. D’un côté comme de l’autre, Dieu se donne lui-même à travers des médiations humaines, visibles ou audibles. Dans les deux cas, les effets touchent au coeur de l’être humain, non seulement instruit, mais également illuminé, sauvé, guéri.
Ce parallèle n’est pas nouveau : avant d’être déployé dans la prédication baroque avec la fameuse comparaison de « la chaire et de l’autel », il émerge chez des auteurs aussi anciens qu’Origène, Jérôme ou Jean Chrysostome ; chez de grands docteurs comme Augustin, Bernard et Bonaventure ; en Orient comme en Occident. On le retrouve dans les préparations au baptême du Ve siècle, dans les vies de saints du VIIIe siècle et plus tard chez un grand prédicateur et universitaire parisien comme Jean Gerson.
Mais qu’est-ce qui est comparé exactement ? Dans cet ouvrage, des spécialistes explorent cette comparaison : sur une période qui s’étend du IIIe au XVIIe siècle, ils analysent les affirmations et les images qui la soutiennent. Cette enquête historique ouvre un chemin pour penser à nouveaux frais la nature et le sens de la prédication dans les Églises d’aujourd’hui.
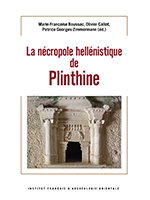
Marie-Françoise Boussac, Olivier Callot, Patrice Georges-Zimmermann (éd.), Le Caire, IFAO, 2023, FIFAO 90.
La nécropole hellénistique de Plinthine, située à environ 800 m à l’ouest de l’établissement urbain de Kôm el Nogous/Plinthine, aux marges occidentales de la chôra alexandrine, a été aménagée sur et dans la ride de calcarénite ou ténia qui sépare la Méditerranée du lac Mariout. Elle a été célébrée depuis les premières fouilles par Achille Adriani en 1937, suivies de diverses interventions non publiées, comme une version miniature des grandes nécropoles alexandrines, mais elle n’avait pas fait l’objet d’une étude globale alliant analyse architecturale et enquête sur les pratiques funéraires. La politique suivie par la mission (MFTMP) – relevé architectural systématique d’une nécropole trop souvent analysée à travers le prisme de quelques hypogées, accent mis sur le phasage, études anthropologiques – a permis de donner une vision plus globale de la nécropole de Plinthine que celle fournie par les études antérieures : les morts ne sont plus absents et la nécropole retrouve une histoire parallèle à celle de la bourgade hellénistique de Plinthine.

Texte introduit, traduit et commenté par Valentin Decloquement, Paris, Les Belles Lettres, 2023, La Roue à livres.
Au début du IIIe siècle apr. J.‑C., le sophiste athénien Philostrate décide de restaurer la mémoire d’Apollonios de Tyane, figure controversée du Ier siècle, accusée de charlatanisme et de sorcellerie. À contre-courant de l’opinion répandue, la Vie d’Apollonios de Tyane brosse le portrait d’un grand sage injustement oublié, d’un philosophe pythagoricien qui brille par sa tempérance et par son ascétisme, d’un homme divin dont les pouvoirs dépassent l’entendement. Accompagné de son fidèle disciple Damis, Apollonios accomplit un voyage initiatique à travers le monde connu de la Méditerranée, jusqu’à ses mystérieux confins en Inde et en Éthiopie. Champion d’une culture grecque incluse dans l’Empire romain, il se fait le conseiller politique de souverains désireux de bien régner, mais doit également se confronter à des empereurs tyranniques, hostiles à la philosophie.
À la croisée des chemins littéraires, l’œuvre de Philostrate est tout aussi insaisissable que son héros : vie de philosophe, discours apologétique, récit de voyage aux allures romanesques, fiction historique avant l’heure… ce texte païen n’est pas non plus sans rappeler les Évangiles. La Vie d’Apollonios est longtemps restée connue comme un texte subversif, susceptible de mettre à mal l’autorité du Christ lui-même ; mais elle n’a pas manqué de séduire la postérité par sa couleur mystique, par sa teneur poétique, ou encore par son caractère ludique.

Madalina Dana (éd.), Bordeaux, Ausonius, 2023, Scripta antiqua 168.
Les lettres privées, inscrites sur des supports très variés comme le papyrus, les tessons de céramique, les tablettes en bois ou en terre crue ou bien le plomb, échangées entre de parfaits inconnus de l’histoire, représentent une source originale et insuffisamment exploitée pour l’histoire économique, sociale et culturelle de l’Antiquité. Les territoires concernés par les échanges épistolaires sont très vastes, allant de l’Orient mésopotamien, assyrien et perse jusqu’à l’Occident romain en passant par l’espace égéen, sur des centaines voire des milliers d’années, montrant ainsi l’évolution des pratiques et l’ampleur des transferts culturels.
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Page suivante
- Dernière page
