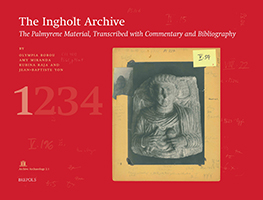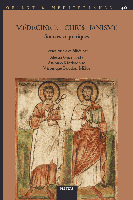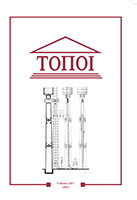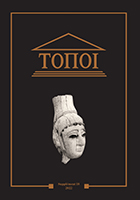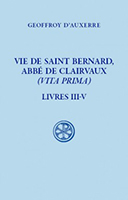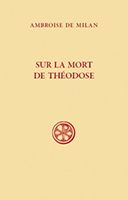Texte latin de Victoria Zimmerl-Panagl (CSEL 106), introd., trad. et notes par Yves-Marie Duval et Benoît Gain, Paris, Le Cerf, 2022, Sources Chrétiennes 629.
Le 17 janvier 395, Théodose Ier (le Grand), seul empereur régnant, meurt subitement à Milan, à l’âge de cinquante ans à peine. Au mois de septembre précédent, à la bataille du Frigidus (la rivière Froide, en Slovénie actuelle), il a triomphé de l’usurpateur Eugène, artisan d’une « réaction païenne ». À cette date, longtemps tenue pour une charnière entre l’Antiquité et le Moyen Âge, le pouvoir impérial n’est pas pleinement assuré, d’autant que Théodose laisse deux fils, âgés seulement de dix-sept et dix ans : Arcadius et Honorius.
Lors des funérailles célébrées quarante jours plus tard, Ambroise de Milan, qui s’était entretenu peu avant avec l’empereur, se montre pleinement conscient de la gravité de la situation politique. Il invite tout d’abord les deux fils, Arcadius et Honorius, à continuer l’œuvre de leur père ; puis, faisant l’éloge des vertus chrétiennes, il prône la clémence et place, dans la bouche de Théodose, les paroles du Psaume 114, développant ensuite l’éloge de l’empereur défunt et concluant sur les retrouvailles célestes.
Cette oraison funèbre présente la particularité de contenir aussi un long développement narratif : la découverte à Jérusalem par Hélène, mère de Constantin, de la Croix et des clous de la Passion, puis leur présence sur le diadème, rappelant aux deux fils leurs devoirs – des recommandations dignes d’un « miroir des princes », dont la postérité se souviendra.
Présentation