Colloque international organisé par S. Coin-Longeray (Université Jean-Monnet-Saint-Étienne, HiSoMA) et D. Vallat (Université Lumière Lyon 2, HiSoMA)
- les 27-28-29 mai 2013 - Saint-Etienne et Lyon
- Télécharger le programme (.pdf)
Archives
La prochaine séance aura lieu le vendredi 24 mai 2013, à 11h, dans la salle de documentation de l’Institut des Sources Chrétiennes, 22 rue Sala, Lyon 2e :
Dominique Gonnet (HiSoMA) : L’homélie Cathédrale 77 de Sévère d’Antioche conservée en grec sur les divergences entre les récits de la Résurrection
Résumé :
Plusieurs Pères grecs cherchent à réconcilier les quatre Évangiles entre eux, en particulier leurs récits respectifs de la Résurrection. Sévère d’Antioche en est un représentant d’autant plus intéressant que ses écrits ont été condamnés par Justinien et qu’il ne subsiste le texte grec que de l’une de ses homélies, alors qu’elles sont toutes conservées en syriaque. Je réfléchirai au pourquoi de cette conservation à partir de son attribution à Hésychius de Jérusalem et à Grégoire de Nysse. L’une des raisons pourrait être le génie propre de Sévère dans l’art de cette réconciliation, art que l’on ne peut soupçonner d’hétérodoxie. Mais en même temps, ses positions dogmatiques transparaissent dans sa manière d’interpréter les Évangiles, manifestant ainsi comment exégèse et dogme sont intrinsèquement liés.
Table ronde internationale sur la numismatique de l'époque romaine.
Monnayage impérial romain. Corpus - Ateliers.
- les 13 et 14 mai 2013 - amphi Benveniste - MOM - 7 rue Raulin - Lyon 7e - Entrée libre.
- Présentation (.pdf)
- Programme détaillé (.pdf) et résumés des communications (.pdf)
- Affiche (.pdf)
La prochaine séance se tiendra le lundi 6 mai 2013 de 13h30 à 16h30, en salle J.Reinach à la MOM.
Au programme : une discussion interdisciplinaire entre Virginie Hollard, historienne (Université Lyon 2), et Emmanuelle Raymond, spécialiste de littérature latine (Université d'Angers) :
"Les damnés de la mémoire" : sources épigraphiques et pratiques poétiques augustéennes.
Contact: Pascale Brillet-Dubois et Nadine Le Meur-Weissman
Une journée d'études consacrée au grammairien Pompée. Louis Holtz (IRHT) interviendra le matin et Anna Zago (doctorante de la Scuola Normale Superiore di Pisa) présentera ses travaux l'après-midi.
- mercredi 24 avril 2013 - de 10h30 à 16h - salle de visioconférence - MOM - 7 rue Raulin - Lyon 2e
- Contacts : Alessandro Garcea et Julie Damaggio
Regards croisés entre sciences historiques et sciences politiques
Colloque organisé par Virginie Hollard (HiSoMA) et Raphaël Barat (LARHRA)
Université Lumière-Lyon 2 et Maison de l’Orient Méditerranéen, 18-20 avril 2013
Télécharger le programme (.doc) / Télécharger l'affiche (.pdf)
Université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude Bernard, Salle des colloques (les 18-19) (Bât. Erato, salle ER20)
Maison de l’Orient Méditerranéen, 7 rue Raulin, Amphithéâtre Benveniste (le 20), Lyon 7e
Virginie Hollard (HiSoMA-UMR 5189) - Raphaël Barat (LARHRA- UMR 5190)
Programme
- Jeudi 18/04/13 (salle des colloques Université Lumière-Lyon 2)
9h-9h30: Ouverture du colloque (interventions de Michèle Brunet, directrice d’HiSoMA, de Bernard Hours, directeur du LARHRA)
9h30-10h : Introduction du colloque (Virginie Hollard et Raphaël Barat)
10h-12h45 : Session 1 : Sélections, tirages au sort et mandats impératifs (Président de séance Robinson Baudry, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense)
10h-10h30 : Christophe Badel (Université Rennes 2) : « Le tirage au sort dans les élections romaines ».
10h30-11h : Liliane Rabatel (IRAA, Maison de l’Orient Méditerranéen) : « Le vote dans le monde grec : procédures et équipement».
Pause café
11h15-11h45 : Raphaëlle Laignoux (Université Paris 1) : « L’élection avant le vote : la sélection des candidats aux magistratures à la fin de la République romaine (49-27 av. n.è.) ».
11h45-12h15: Christophe Le Digol (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense) : « De la représentation liée à la représentation libre : l’élection au début de la Révolution française ».
12h15-12h45 : discussion
Déjeuner
14h30-18h : Session 2 : Procédures (Président de séance Christophe Voilliot, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense)
14h30-15h : Clément Chillet (Université Lyon 2) : « Le vote par correspondance à Rome : enjeux et réalités d'une pratique singulière ».
15h-15h30 : Robinson Baudry (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense) : « Le rôle du président des comices et la question du contrôle aristocratique des élections romaines ».
15h30-16h : discussion
Pause café
16h15-16h45 : Philippe Tanchoux (Université d’Orléans) : « Savoir faire et renouveau électoral : l’expérience des élections administratives des assemblées provinciales de 1778 à 1787 ».
16h45-17h15 : M. et T. Crook (Université de Keele) : « Une technologie démocratique? L’adoption du bulletin et l’acte de vote en France, dans la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ».
17h15-17h45 : discussion
18h : Pot à la Maison de l’Orient Méditerranéen (Hall de la Bibliothèque).
Dîner
- Vendredi 19/04/13 (salle des colloques Université Lumière-Lyon 2)
9h-9h30 : Ouverture par M. Jean-Luc Mayaud, Président de l’Université Lumière-Lyon 2
9h30-12h15 : Session 3 : Elections et symbolique du pouvoir (Président de séance Raphaël Barat, Université Lyon 2)
9h30-10h : Corinne Péneau (Université Paris 12- Créteil Val de Marne) : « Les élections en Suède à la fin du Moyen Âge. Pratiques et théories croisées ».
10h-10h30 : Cédric Plont (Université Paris Ouest-Nanterre La Défense) : « Elire un Roi. Retour sur une tentative électorale autour des Etats généraux de 1593 ».
10h30-11h : discussion
Pause café
11h15-11h45 : Dietrich Poeck (Université de Münster) : « Temps et pouvoir ».
11h45-12h15 : Louis Grossman Wirth (Université Grenoble 2) : « Voter à la Diète impériale (1521-1555). Figuration d'un corps collectif ou outil de décision politique ? ».
12h15-12h45 : discussion
Déjeuner
14h30-17h15 : Session 4 : La fabrique de la politique (Président de séance Philippe Tanchoux, Université d’Orléans)
14h30-15h : Rémi Lefebvre (Unviersité Lille 2) : « Elections municipales et construction du jeu politique local. Le cas de Roubaix (1892-1902) ».
15h-15h30 : Francisco Roa Bastos (Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines) : « Sociogenèse de l’élection du Parlement européen au suffrage universel : discours et mobilisations ».
15h30-16h : discussion
Pause café
16h15-16h45 : Yann Ligneureux (Université de Nantes) : « L'impossible vote dans la colonie de Québec au XVIIe siècle ».
16h45-17h15 : Gaëlle Charcosset (Université Lyon 2) : « A la recherche de la légitimité : les élections municipales dans l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône au 19è siècle et au début du 20è ».
17h15-17h45 : discussion
Dîner
- Samedi 20/04/13 (Amphithéâtre Benveniste, Maison de l’Orient Méditerranéen)
9-12h15 : Session 5 : Brigues et mauvaises élections (président de séance Corinne Péneau, Université Paris 12)
9h-9h30 : Virginie Hollard (Université Lyon 2) : « Brigue, compétition et crise électorale entre la fin de la République et le début du Principat ».
9h30-10h : Maud Harivel (Université de Bern) : « Giustizia distributiva et broglio : la corruption électorale à Venise aux XVIè et XVIIè s. ».
10h-10h30 : discussion
Pause café
10h45-11h15 : Jérôme Loiseau (Université de Franche-Comté) : « Comment faire l’élu de la noblesse aux états généraux du duché de Bourgogne au Grand Siècle ? ».
11h15-11h45: Raphaël Barat (Université Lyon 2) : « Microhistoire d’une brigue : l’élection des syndics de Genève en Janvier 1694 ».
11h45-12h15 : discussion
12h15-13h : Conclusions du colloque (Nathalie Dompnier, Université Lyon 2)
La prochaine séance aura lieu le vendredi 12 avril 2013, à 11h, dans la salle de documentation de l’Institut des Sources Chrétiennes, 22 rue Sala, Lyon 2e :
Sébastien GRIGNON, L’Écriture dans les Catéchèses prébaptismales de Cyrille de Jérusalem
Lire le résumé de l'intervention (.pdf)
Séminaire organisé par B. Cabouret (Professeur à Lyon 3 / HiSoMA)
Neil McLynn (University Lecturer in Later Roman History, Corpus Christi College, Oxford) présentera une conférence intitulée : 'Poetry Against Pagans: the "Certain Senator Converted from the Christian Faith" '
Mercredi 10 avril 2013. 16-18 heures au CEROR. 18 rue Chevreul 4ème étage
La table-ronde « Ecdotique : l'édition des textes anciens en devenir » s'est tenue à Lyon, le 8 mars 2013, dans les locaux de l'Institut des Sources Chrétiennes où le stage d'ecdotique venait d'avoir lieu. Ce stage, qui regroupe chaque année des étudiants venus de France et d’autres pays, avait mis à l’honneur dès 1994, sur la suggestion du papyrologue Louis Doutreleau, le terme « ecdotique » qui désigne l’art d’éditer des textes ou, plus largement, des sources.
L'événement, organisé par le laboratoire HiSoMA (Histoire et sources des mondes antiques), avait pour but de manifester l'intérêt et l'importance des éditions critiques en cours à Lyon comme ailleurs et de permettre des échanges sur les méthodes employées, les difficultés rencontrées ou les nouvelles perspectives, dans une démarche pluridisciplinaire. Historiens ou littéraires, archéologues ou purs philologues, épigraphistes ou papyrologues, antiquisants ou médiévistes, latinistes, hellénistes ou spécialistes de langues orientales, ils sont nombreux, en effet, à pratiquer le même art : l'ecdotique ignore le cloisonnement des disciplines universitaires.
Pour sa première édition, cette table-ronde a accueilli principalement des éditeurs de textes médiévaux ou patristiques, permettant notamment de fructueux échanges entre divers spécialistes des lexiques latins.

Après un rapide tour de table, Franck Cinato, du Laboratoire d’histoire des théories linguistiques, ou HTL, a présenté la première communication, intitulée : « L’édition critique du Liber glossarum. Quel Liber éditer ? » En voici le résumé : « Le projet Liber glossarum : Edition of a Carolingian encyclopaedia, dirigé par Anne Grondeux et sélectionné en 2010 par l’European Research Council) permettra de produire la première édition intégrale de cette vaste encyclopédie. Cette édition constitue le socle essentiel à l’analyse des lexicographes médio-latins, car le Liber glossarum matérialise le lien entre l’encyclopédisme d’Isidore de Séville et les dictionnaires alphabétiques du Moyen Âge central. Projet en cours, il permet déjà d’effectuer un dépoussiérage complet de l’histoire de ce texte fondateur de la lexicographie occidentale, dont la conception se joue en toile de fond des grandes réformes de la renovatio carolingienne. Les plus grands savants de l’époque ont été impliqués, avec dans les rôles principaux, Alcuin, Adalhard de Corbie, cousin de Charlemagne, et Théodulf d’Orléans. Sa tradition manuscrite raconte l’histoire d’une fabrication complexe, à laquelle plusieurs centres ont pris part, dans un bouillonnement de textes nourri par un milieu multiculturel. Le résultat a été un énorme outil de référence indémodable jusqu’au XVe siècle où il est imprimé, malgré sa taille imposante et la refonte effectuée par Papias au milieu du XIe siècle. Pourtant, il paraît avoir été diffusé dans la précipitation sans y apporter le degré d’achèvement attendu et bien que plusieurs tentatives de sauvetage semblent avoir eu lieu au cours de la première moitié du IX e siècle, le texte demeura toujours instable. Manipulé tout au long de son histoire, le Liber Glossarum pose un certain nombre de problèmes, qu’une édition électronique pourrait surmonter. »
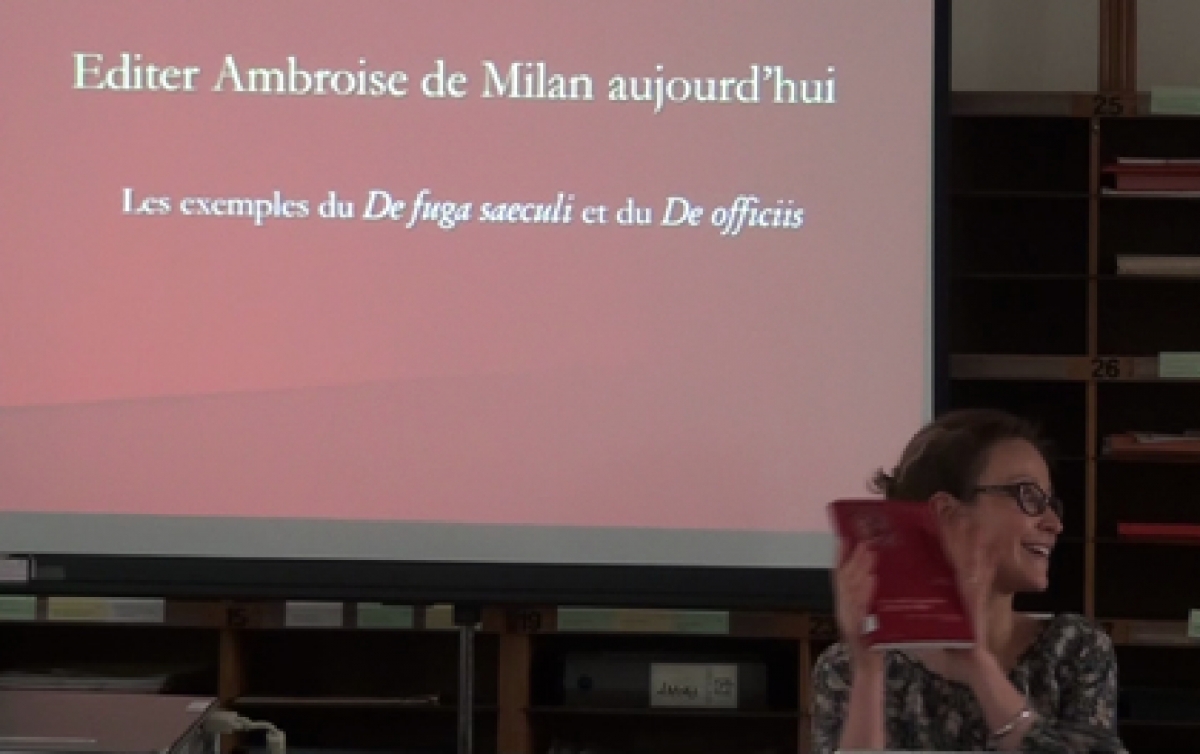
Camille Gerzaguet, de l’Université d’Aix-marseille, a ensuite offert un exposé sur « Éditer Ambroise de Milan aujourd’hui. Les exemples du De fuga saeculi et du De officiis ». Voici le résumé qu’elle en fait : « Depuis le colloque Lire et éditer Ambroise de Milan aujourd’hui qui s’est tenu à Metz en 2005, de nouvelles éditions des œuvres ambrosiennes commencent à paraître. Le cas le plus récent est celui du De Iacob et uita beata, édité par G. Nauroy et paru en 2010 dans la collection des Sources Chrétiennes. Plusieurs chantiers personnels ou collaboratifs (œuvres exégétiques, correspondance) sont en cours dans cette collection. Ainsi, le De fuga saeculi, auquel j’ai consacré ma thèse de doctorat, est actuellement en préparation. Cette nouvelle édition se justifiait par les défauts de l’édition précédente procurée par K. Schenkl en 1897 à l’occasion du mille cinq centième anniversaire de la mort d’Ambroise et parue dans le CSEL. Si méritoire que fût cette « édition anniversaire », elle n’en présentait pas moins un certain nombre d’insuffisances parmi lesquelles l’absence de stemma codicum et l’exclusion des témoins copiés en Italie de l’établissement du texte sont les plus notables. Il s’agissait donc de construire un stemma et de prendre en compte la version du De fuga saeculi transmise par les témoins italiens. L’édition du De officiis soulève, elle aussi, la question du stemma et de son utilisation, mais sous un angle différent. L’édition de Testard, parue en 1984 dans la Collection des Universités de France et reprise en 2000 dans le Corpus Christianorum, propose un stemma codicum qui est discutable. En effet, non seulement la lecture de l’apparat critique contredit la construction stemmatique, mais deux témoins carolingiens, dont Testard n’a pas tenu compte pour son édition, apportent un éclairage très différent sur la tradition manuscrite. L’étude stemmatique du De officiis est à refaire. »

Marie-Karine Lhommé, de l’Université Lumière-Lyon 2, a quant à elle présenté le cas d'un texte transmis par un manuscrit unique : le lexique de Festus. « Le Farnesianus (Naples, Bibl. Naz. IV.A.3, XIe siècle), précise-t-elle, est acéphale et fortement mutilé : une colonne sur deux de texte est brûlée, et seules les sections alphabétiques M à V sont conservées. Redécouvert à la fin du XVe siècle, il perd encore quelques feuillets ou quaternions entiers lorsqu'il circule dans le cercle de l'Académie de Rome : des apographes réalisés à l'époque comblent imparfaitement ces pertes. Fin VIIIe, Paul Diacre avait réalisé un abrégé pour Charlemagne, éliminant nombre d'informations (articles entiers, sources et citations) : une dizaine de manuscrits sont conservés, qui peuvent donner une idée, si l'on prend des précautions, des parties mutilées ou entièrement perdues. » M.-K. Lhommé a alors exposé les différents principes, mérites et défauts des éditions, de la Renaissance aux deux éditions de W. M. Lindsay (Teubner 1913 et Glossaria Latina 1930), jusqu'au récent Festus Lexicon Project (UCL London).

Jean Reynard, du CNRS (HiSoMA-Sources Chrétiennes), a abordé et illustré « L'enjeu des versions orientales pour l'édition du Mystère des lettres grecques ». Voici la brève présentation qu’il en fait : « Le Mystère des lettres grecques – ainsi désigné selon un titre reconstitué – est un récit de révélation sur le sens secret de l'alphabet grec, mêlant interprétations graphiques, numériques et sémantiques des lettres. Connu depuis le XVIIIes. par un manuscrit copto-arabe d'Oxford (l'arabe figurant dans les marges du manuscrit), il a excité la curiosité des égyptologues et fait l'objet de diverses études qui l'ont rattaché à tort au courant gnostique. La difficulté redoutable du copte et le caractère peu intelligible du texte lui-même ont fait supposer à ces savants un original grec, mais c'est dans sa version copte qu'il est finalement édité et traduit en 1900 par Hebbelynck. On doit au P. J. Paramelle la découverte, dans les années 1970, de la version grecque dans un manuscrit d'Oxford, le Baroccianus 197. Ce dernier reste notre témoin principal, auquel il faut ajouter deux manuscrits grecs, le Parisinus gr. 2314 et le Laudianus 29, qui donnent la fin du récit. On pourrait croire que cette découverte a enlevé son intérêt aux versions orientales, mais ce n'est pas le cas. D'abord, parce que seules les versions copte et arabe ont conservé le début du texte. Ensuite, parce qu'elles ont chacune leur spécificité : la version copte présente des perspectives originales, puisées dans les traditions égyptiennes, notamment en introduisant les astres dans la description du cosmos et la notion de noun, l'océan primordial égyptien. La version arabe, pour sa part, ne semble pas être une traduction de la version copte à côté de laquelle elle figure, elle s'en éloigne parfois et a sa propre spécificité : elle donne par exemple aux anges un rôle que ne leur accorde pas le copte, à mettre peut-être en rapport avec l'angélogie musulmane. Cependant, cette version n'est pas un texte soigné et présente de nombreuses difficultés. Ces trois traditions textuelles méritent donc d'être étudiées chacune à part et en lien les unes avec les autres. »

La table-ronde s'est conclue sur la présentation par Guillaume Bady, du CNRS (HiSoMA-Sources Chrétiennes), d'un projet de site web, dont le nom reste à trouver. Le site serait consacré à l’ecdotique, et plus particulièrement à l'édition traditionnelle des sources anciennes, en lien, bien sûr, avec l’édition numérique qui a déjà son propre espace sur la toile. L'objectif serait moins de fournir des éléments pédagogiques – qui souvent existent déjà sur internet, surtout pour le latin – que de mettre en réseau l'ensemble des insitutions et des personnes engagées dans l'enseignement ou la pratique de l'ecdotique en France, quelle que soit leur discipline d'origine.
La table-ronde, issue du programme « Ecdotique » (A1) du laboratoire HiSoMA, devrait avoir lieu régulièrement chaque année. Elle est ouverte à toutes personnes intéressées, de Lyon ou d’ailleurs.
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- Page suivante
- Dernière page